Note de concordance : 10/10
Si le vent et la tourbe pouvaient enfanter, de leur union serait née cette fratrie : des mots et des sons qui jaillissent de la même écume, venant frapper les sombres rivages insulaires écossais.
Depuis le temps que je choisis des Bandes Originales de Livres, jamais un roman et un album ne se sont aussi bien entremêlés. Il ne s'agit plus de superposition mais de fusion.
Certes "Orkney symphony" suit son propre récit, mais les chansons éthérées se cachent dans les mêmes brumes mystérieuses que "L'île des chasseurs d'oiseaux". Le projet du disque baigne dans le fantasmagorique : Gawain Erland Cooper, le leader de la formation The Magnetic North, a reçu une visite en rêve.
Si, ça se peut.
L'esprit de Betty Corrigall, une jeune femme d'Orkney Island qui s'est pendue au XIIIème siècle, lui a intimé de composer des musiques autour de son histoire. La force du rêve fut telle que Cooper est retourné sur l'île dont il est originaire, concrétisant ce projet fou en embarquant avec lui des artistes avertis, Simon Tong et Hannah Peel (s'appeler Madame Peel, déjà un bon présage).
Orkney Island fait face à l'Ecosse, tout à fait au nord du pays. Un tout petit peu plus bas, à l'ouest, les mêmes vents fouettent Lewis Island.
Comme des aimants, ces îles semblent rappeler leurs habitants à elles. Dans le roman de Peter May, l'inspecteur Fin McLeod retourne sur les terres de son enfance pour enquêter sur un meurtre. Le cœur n'y est pas : le pire vient de lui arriver, il a perdu son fils. Et les souvenirs qu'il a de Lewis sont tourmentés, désagréables. Mais le crime commis (tiens, par pendaison) ressemble trop à une de ses précédentes enquêtes pour qu'il ne soit pas sommé de faire les vérifications nécessaires.
A peine les rives en vue, son passé remonte comme une sombre marée qui va venir provoquer le présent.
Avant d'écrire ce livre, Peter May a fait une longue saga policière située en Chine, une autre en France où il vivait alors. Comme si l'écossais patientait, laissait fermenter les histoires qui touchaient ses fibres les plus intimes… Alors dès les premières pages, l'atmosphère prend une dimension spectaculaire. L'aura de Lewis est palpable. La couleur et l'odeur de la tourbe sont omniprésentes, prégnantes. Les nuits sont fantomatiques, les jours brumeux. La faune est sauvage, la flore est sauvage, mais jamais autant que les habitants. Si on devait cacher un secret, il n'y aurait pas de meilleur endroit que cette terre isolée qui se tait, qui recouvre les traces du passé sous le granite et le basalte.
Les traditions y ont la vie dure. Chaque année quelques hommes et adolescents de l'île se rendent sur un îlot pour y perpétrer un massacre sur les gugas, des oiseaux locaux. Un rite de passage un peu plus bête et cruel que la moyenne des rites de passage.
C'est dans ce contexte que Fin va devoir enquêter, en évitant d'emmêler le fil de l'investigation et celui des souvenirs. A moins que tous les fils ne viennent du même tartan...
Des chœurs évanescents, des percussions tribales, un entrecroisement de vibraphones et de xylophones, des cordes, des arpèges de guitare,... il en faut des instruments pour exprimer la force des landes que foule Fin à la recherche du criminel, contre les bourrasques de souvenirs.
Inspirant parfois la menace latente ("Stromness"), la nostalgie vivace ("Rackwick"), la montée en intensité ("Bay of Skaill"), la musique de The Magnetic North croise le navire d'autres marins de ces mers froides : Sigur rós (dont on avait parlé ici pour seconder l'inspecteur Harry Hole). On retrouve aussi une superbe relecture de "Hi Life" de Syd Matters, dont la version originale utérine avait magnifié les silences de Yoko Ogawa sur ce même blog.
The Magnetic North tisse d'improbables liens entre plages instrumentales introspectives et grandes envolées romantiques où chants, cordes et percussions éclatent à l'unisson. Un peu comme un bijou celte, l'album réussit ce prodige de toujours paraître sensible et solide à la fois. L'eau et la rocaille. Le vent et la tourbe.
Conçu en grande partie sur place, parfois dans la maison même des parents du leader, le son de "Orkney symphony" a été façonné par la géographie de l'île, son histoire, ses habitants (une chorale locale a été montée).
C'est enrobé de cette musique spectrale que j'ai imaginé Fin McLeod tout au long de son périple. Un flic qui recroise son premier amour, les camarades d'antan. Et alternativement ce même personnage lorsqu'il était un gamin, vivant la rudesse de l'île, les rivalités de bandes, les 400 coups… Des images restent, comme celle de ce pneu de tracteur dévalant les courbes de l'île. Des sons remontent, comme cet inquiétant trombone qui surgit parfois, comme un signal marin ancestral, un avertissement du passé d'Orkney.
"L'île des chasseurs d'oiseaux" a la particularité d'être d'abord paru en traduction française, avant sa sortie dans son titre original : "The Blackhouse". Cette maison noire, c'est celle des secrets enfouis, des amnésies nécessaires.
Et si l'on creuse encore plus loin, le livre parle surtout du difficile passage du monde de l'enfance à celui des adultes, cette transition maudite où l'on doit choisir entre insouciance et liberté, renoncer à la naïveté. La tragique destinée de Betty Corrigall, précurseuse du 27 club, morte de trahison et de pression religieuse (enceinte d'un marin l'ayant abandonnée), est un condensé d'illusions perdues dans les eaux salées d'Ecosse. Parfaite cohérence des musiques que The Magnetic North lui a consacré, mêlant si bien innocence et menace, rêverie et fougue. L'eau et la rocaille. Le vent et la tourbe.
Cela va de soi, la trilogie entière de Peter May fonctionne parfaitement avec ce disque. Je n'irai plus jamais sur Lewis Island sans "Orkney symphony".
Plus encore qu'un documentaire retraçant la création de l'album, une immersion dans Orkney.



/image%2F0668769%2F20190403%2Fob_aae97f_iles-ecossaises-2.jpg)
/image%2F0668769%2F20190403%2Fob_13a7e8_iles-ecossaises.jpg)

/image%2F0668769%2F20190414%2Fob_baf0c6_trilogie-ecossaise.png)
/image%2F0668769%2F20190414%2Fob_8df758_ecosse-may.jpg)


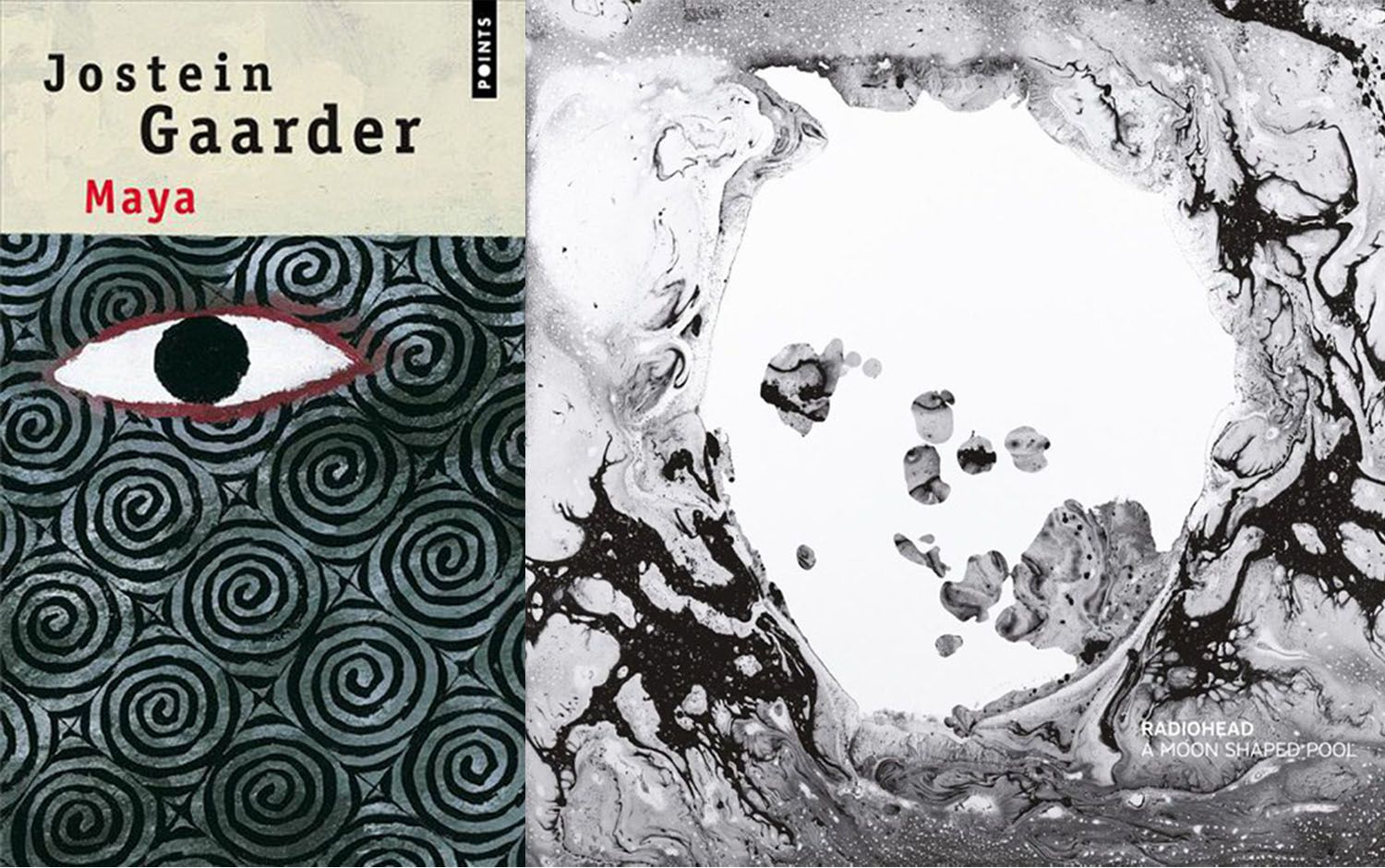


/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FTi6qhk3tX2s%2Fhqdefault.jpg)







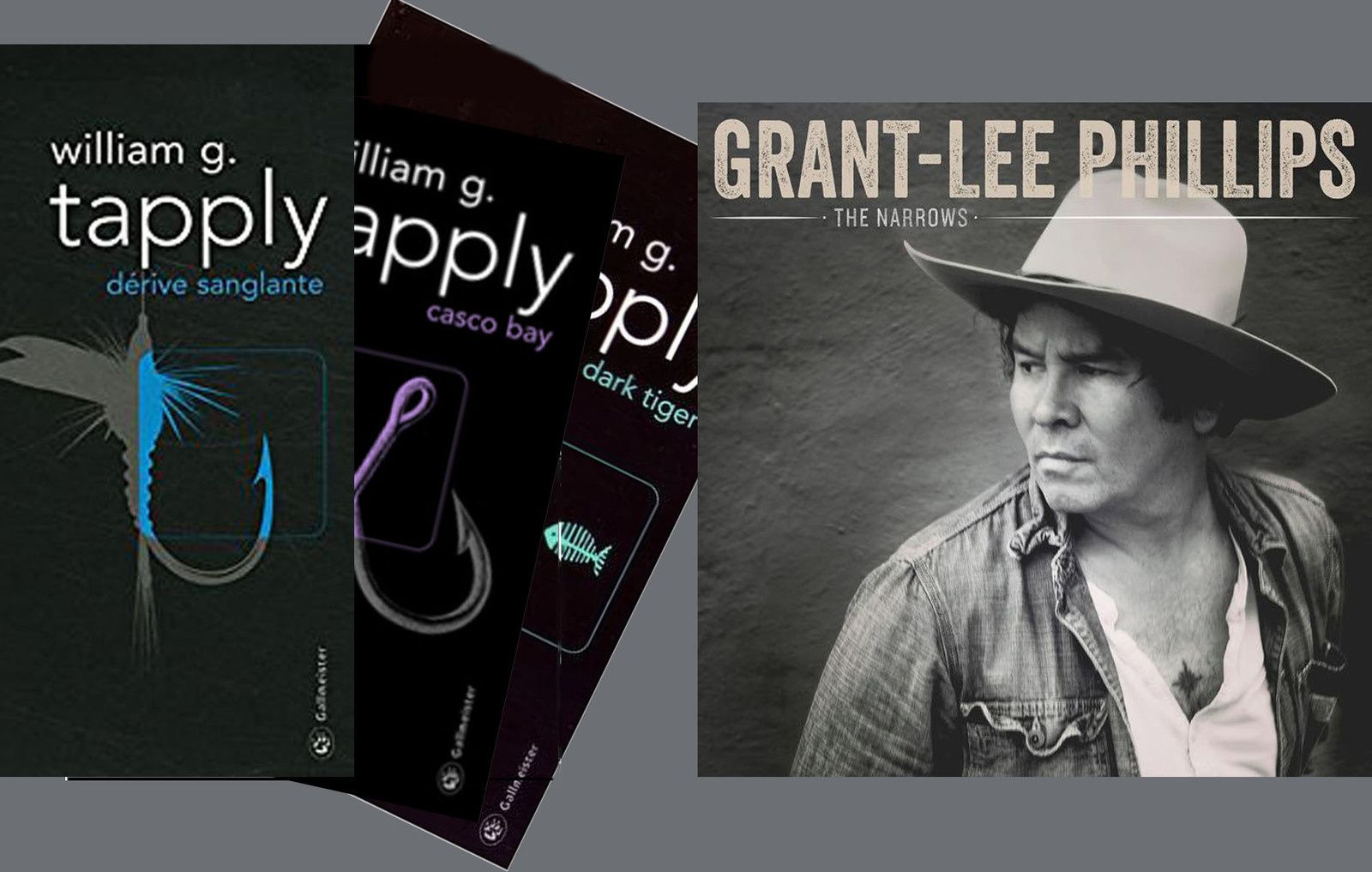




/image%2F0668769%2F20170113%2Fob_50de82_fink2.jpg)
/image%2F0668769%2F20170113%2Fob_9ed641_fink.jpg)






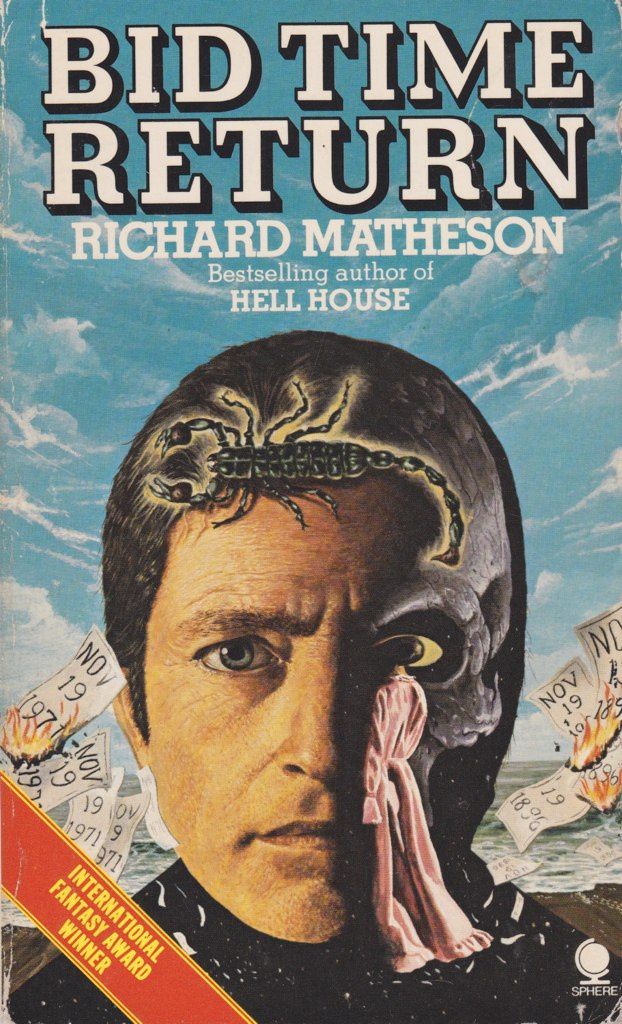


/image%2F0668769%2F20160529%2Fob_7ff843_somewhere-in-time.jpg)
/image%2F0668769%2F20160529%2Fob_f2cf49_richard-matheson.jpg)

/image%2F0668769%2F20160331%2Fob_95d791_houellebecq.jpg)
/image%2F0668769%2F20160331%2Fob_cb340b_michel-houellebecq-fait-de-la-politiqu.jpg)
/image%2F0668769%2F20160331%2Fob_2a04e1_hqdefault.jpg)
/image%2F0668769%2F20160331%2Fob_bf4e10_philippe-katerine-m.jpg)
/image%2F0668769%2F20160331%2Fob_9a5836_houellebecq-2.jpg)
/image%2F0668769%2F20160331%2Fob_27dd1e_3791529-photo-2-545x460-autocrop.jpg)

